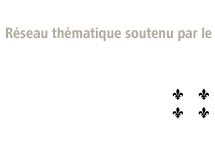Félicitations à nos lauréat.e.s du concours de soutien à la publication scientifique 2022-2023.
Découvrez leurs résumés !
Nathalie Auger (UdeM) et al. “Suicide Attempts in Children Aged 10–14 Years During the First Year of the COVID-19 Pandemic. Journal of Adolescent Health. In press (March 2023)
Une publication soutenue par le RRSPQ
Audrée Jeanne Beaudoin (USherbrooke) et al. « Intervention positive visant le développement des habiletés socioaffectives des enfants de 4 à 8 ans en milieu scolaire ».
Une publication soutenue par le RRSPQ
Résumé
Introduction De plus en plus de données suggèrent qu’une approche de santé publique doit être mise en place pour promouvoir la santé mentale positive des jeunes. Sachant que la santé mentale chez les jeunes est étroitement liée à leur environnement social, il est importance de miser sur l’amélioration de la qualité de l’environnement socioéducatif, incluant la maison, l’école et la communauté afin de promouvoir le développement des habiletés sociales et affectives des enfants. Une réorganisation importante des services de promotion de la santé mentale et des habiletés socioaffectives des jeunes a été entamée au CIUSSS de l’Estrie en adoptant une approche développementale nommée Intervention Positive (IP). Cette offre de service inspirée des principes de la psychologie positive n’a jamais été documentée et sa grande flexibilité peut mener à une variabilité dans son implantation.
Méthodes Cet article vise à décrire l’implantation de l’IP déployée conjointement par la santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et les milieux scolaires de leur territoire selon le cadre conceptuel pour les soins de santé et services sociaux intégrés en proximité des communautés (SSSSI).
Résultats L’IP intègre plusieurs composantes des SSSSI et tend vers un modèle de services sociaux intégrés en proximité des communautés. En effet, l’IP offre surtout des services sociaux centrés sur la promotion des habiletés sociales et affectives des enfants et la prévention des comportements antisociaux développés pour et avec les partenaires locaux (ex. : écoles). Pour ce faire, l’IP mise sur une forte proximité relationnelle et spatiale avec les partenaires scolaires et le respect de la temporalité des acteurs afin de codévelopper un plan d’action adapté à la réalité de chaque territoire. Toutefois, peu de liens avec les services de santé de première ligne ont été développés après les 6 premiers mois d’implantation.
Conclusion Le présent article démontre qu’il est possible de développer et d’implanter des services visant le développement optimal des habiletés sociales et affectives et la promotion de la santé mentale positive chez les enfants avec et pour les communautés locales. Il est toutefois nécessaire de poursuivre la recherche afin de documenter la validité sociale perçue par tous les acteurs concernés et d’ajuster et bonifier l’offre de services.
Kimberly Borwick (USherbrooke) et al. « Enjeux de sécurité culturelle concernant la transplantation et le don d’organe : perspectives de personnes issues des Premières Nations et professionnelles de la santé ».
Une publication soutenue par le RRSPQ
Résumé
Objectif Décrire et comprendre les facilitateurs et les barrières en matière de sécurité culturelle pour les personnes issues des Premières Nations concernant la transplantation et le don d’organe.
Type d’étude Étude qualitative descriptive interprétative avec approche décolonisatrice à double perspective.
Contexte Québec, Canada.
Participants Onze personnes dont cinq professionnels de la santé et six personnes membres des Premières Nations.
Méthodes Des entrevues semi-dirigées menées entre mai et septembre 2021 auprès de membres des Premières Nations et de professionnels de la santé ayant vécu une expérience concernant la transplantation ou le don d’organe.
Principales constatations Cette étude a permis d’identifier plusieurs facteurs individuels et contextuels influençant la sécurité culturelle concernant la transplantation et le don d’organes chez les membres des Premières Nations : la barrière linguistique, les impacts de la relocalisation, la méconnaissance en matière de transplantation, la méfiance envers le système de santé, le soutien familial et l’accompagnement et le partage de témoignage de transplantation.
Conclusion Cette étude indique plusieurs pistes pour renforcer la sécurité culturelle vis-à-vis le don et la transplantation d’organes chez les membres Premières Nations, notamment prioriser la présence d’un accompagnateur, miser sur l’accès à un hébergement culturellement sécurisant et partager les témoignages de transplantation. D’autres travaux en partenariat avec les membres des Premières Nations sont nécessaires afin d’améliorer l’accès à la transplantation d’organes, tout en actualisant leur sécurité culturelle.
Sarah Cooper (UdeM) et al. “Age-appropriate full vaccination coverage in children 0-14 months in Burkina Faso: Trends between 2010-2021 and repercussions of COVID-19”.
Une publication soutenue par le RRSPQ
Résumé
Background Improving infant immunization completion is key to reducing under-5 childhood mortality. While several have hypothesized that the COVID19 pandemic would disrupt the delivery of health services and immunization campaigns in low- and middle-income countries, evidence remains scarce. We conducted a study in rural Burkina Faso with two main objectives: 1) to assess changes in vaccination coverage during the pandemic and 2) to examine trends in vaccination coverage throughout 2010-2021.
Methods Five rounds of household surveys (2010, 2015, 2019, 2020, and 2021) from Burkina Faso were pooled together to assess the vaccination coverage and completion of the basic immunization schedule. The population under study comprised all infants aged 0-13 months from a sample of 325 households randomly selected in eight districts. Vaccination coverage was assessed per direct observation of the infants’ booklet. Analyses used multilevel logistic regression models with random intercepts at the household and district levels.
Results A total of 736 child-year observations were included in the analysis. The proportion of children with age-appropriate full vaccination was 69.76% in 2010, 55.38% in 2015, 50.47% in 2019-2020 and 64.75% in 2021. Analyses assessing changes in age-appropriate full vaccination coverage before and during the pandemic show heterogenous effects amongst the health districts and the different vaccines. This is likely due to lower coverage in the districts surveyed in 2019 compared to those surveyed in 2020. The analyses suggest no disruption in age-appropriate full vaccination due to COVID19.
Discussion Our findings in Burkina Faso do not support the predicted detrimental effects of COVID19 on the immunization schedule for infants in LMICs. Coverage in age-appropriate full vaccination had decreased between 2010 and 2019 possibly due to the addition of new vaccines. Analyses comparing 2019 and 2021 show an improvement in age-appropriate full vaccination. Regardless of achieving and sustaining vaccination coverage levels in Burkina Faso, this should still remain a priority for health systems and political agendas.
Mélanie Levasseur (USherbrooke) et al. “Impact of COVID‑19 on trajectories of older Canadians’ depressive symptoms between 2018 and 2020: results from a Canadian Longitudinal Study on Aging multilevel study exploring the protective effect of communities’ age-friendliness”.
Une publication soutenue par le RRSPQ
Résumé
Contexte : La pandémie de COVID-19 a eu un effet généralisé sur la santé mentale. Les municipalités amies des aînés (MADA) sont un moyen prometteur d'accroître le soutien dans les communautés, mais on connait peu leur effet protecteur sur les symptômes dépressifs. Cette étude visait à explorer les effets protecteurs potentiels d'un plan d'action MADA, et d'autres caractéristiques, sur les trajectoires des symptômes dépressifs des personnes âgées au cours des premiers mois de la pandémie.
Méthode : Les analyses ont été réalisées avec: 1) le premier suivi de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ELCV) (2015-2018), l’étude par questionnaire sur la COVID-19 de l'ELCV (2020), 2) une enquête sur les démarches MADA des municipalités, et 3) le recensement (2016). Les répondants (n=6659) vivaient dans 50 municipalités comptant au moins 20 répondants. Les symptômes dépressifs ont été évalués à l'aide du questionnaire CES-D-10. Une modélisation des classes latentes a attribué une trajectoire de symptômes dépressifs aux répondants. Les trajectoires ont été prédites par des modèles logistiques multiniveaux.
Résultats : 66,1% des répondants avaient une trajectoire stable et non-dépressive, 28,1% une trajectoire déclinante, et 5,8%, une trajectoire dépressive. Les plans d'action MADA, en place dans la moitié des communautés avant la pandémie (n=26), n'ont pas eu d'effet protecteur. Être une femme, se sentir seule, un revenu plus faible, des conditions chroniques, participer moins souvent à la vie sociale, un sentiment d'appartenance inférieur, une infection probable ou confirmée par la COVID-19 et subir du stress lié à la pandémie prédisait une trajectoire dépressive. La défavorisation matérielle de la municipalité avait un effet protecteur vis-à-vis la trajectoire déclinante.
Conclusion : Un plan d'action MADA ne présentait pas d'avantages vis-à-vis les trajectoires de symptômes dépressifs durant la pandémie, mais disposer de volontaires pour faciliter l'accès aux ressources et aux interactions sociales aurait pu limiter la hausse des symptômes dépressifs.
Marie-Hélène Lévesque (USherbrooke) et al. “Social prescribing and preventive occupational therapy: A greater way to cope with adversity?”
Une publication soutenue par le RRSPQ
Résumé
Cet article présente une synthèse des connaissances sur la prescription sociale et ses liens avec le programme Remodeler sa vie : une intervention d’ergothérapie préventive visant le développement de modes de vie sains et l’optimisation de la participation sociale. Plus précisément, l’article présente la définition de la prescription sociale, son utilisation dans les systèmes de santé et sociaux canadiens et mondiaux, ses effets probants, ses critiques et ses retombées en contexte de pandémie. Puisque la prescription sociale partage plusieurs affinités avec le programme Remodeler sa vie, l’article pose aussi un regard sur les zones de compatibilité et de tension ainsi que sur la façon dont l’implantation de ces deux interventions pourrait catalyser les efforts mondiaux vers une société plus juste et en meilleure santé, et ce, en présence d’une situation d’adversité ou non.
Nolwenn Noisel (UdeM) et al. Environnement et santé publique, fondements et pratique, 2e édition
Une publication soutenue par le RRSPQ
Résumé à venir
Lauriane Ouellet (ULaval) et al. “Healthy development of urban Inuit children: A look at the needs and resources to support Inuit families in southern Quebec.”
Une publication soutenue par l’axe Inégalités sociales de santé et équité
Résumé à venir
Cheick Oumar Tiendrebéogo (UdeM) et al. « La suppression du ticket modérateur pour la planification familiale augmente-t-elle l'utilisation de la contraception? Une évaluation d'impact de la politique nationale au Burkina Faso ».
Une publication soutenue par le RRSPQ
Résumé
Plusieurs études ont montré que la barrière financière constitue un obstacle à l’accès et à l’utilisation de la planification familiale dans les pays à ressources limitées. L’adoption d’une politique de gratuité de la planification familiale pourrait donc augmenter l’utilisation des méthodes contraceptives dans les milieux défavorisés. Nous rapportons les résultats d’une étude pré-post avec un groupe témoin non randomisé au Burkina Faso dont l’objectif était d’évaluer les effets de la politique de gratuité de la planification familiale sur l’utilisation des méthodes contraceptives initiée pour la première fois sous forme de projet pilote en juillet 2019 dans deux régions (Cascades et Centre-Ouest) et qui s’est étendue une année plus tard à l’échelle nationale. Un questionnaire ciblant les indicateurs de santé sexuelle et reproductive extrait des instruments du programme d’Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS), a été administré individuellement à toutes les participantes. Les questions ont été posées en langues locales (Moore, Dioula, Lélé, Fufuldé, Gourmantché) aux domiciles des participantes par des enquêtrices expérimentées. Ces questions portaient principalement sur la connaissance de l'existence de la nouvelle politique de gratuité de la PF, l'utilisation actuelle de contraceptifs, l'activité sexuelle, les intentions de procréation et l'historique des grossesses, et le fait d'avoir été récemment en contact avec un professionnel de santé.
Six mois après sa mise en oeuvre, 65% des participantes étaient au courant de l’existence de la politique de gratuité de la PF. Cette gratuité a entrainé une augmentation de 86% de l’utilisation des méthodes contraceptives et le fait d’être au courant de cette nouvelle politique était significativement associée à une probabilité accrue de 46% d’utiliser la contraception parmi les femmes en âge de procréer. Cette politique a réduit de 13 points de pourcentage la prévalence des besoins non satisfaits en matière de contraception. Des résultats similaires ont été retrouvés dans d’autres études précédentes qui ont montré une utilisation accrue des services de santé à la suite de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso. Nos résultats suggèrent que la politique de gratuité de la PF est une bonne stratégie permettant d’augmenter l’utilisation des méthodes contraceptives auprès des femmes dans les pays à ressources limitées.
Ran van der Wal (McGill) et al. “Improving the HIV-sensitivity of socioeconomic empowerment programs in Botswana: A modified Policy Delphi with vulnerable young women and frontline service providers”.
Une publication soutenue par le RRSPQ
Résumé
Introduction: Although at high risk of HIV infection, unemployed and out-of-school young women in Botswana rarely benefit from available socioeconomic programmes that could empower them to act on HIV prevention choices. To inform how these programs could become more HIV-sensitive, we investigated support among young women and frontline service providers for improvement proposals generated in prior research, and examined how their views differed.
Methods: Using a modified Policy Delphi, a panel of 22 young women and 8 frontline service providers rated 33 improvement proposals for desirability and feasibility (Round 1), ranked them for relative importance (Round 2), and contributed rationales, implementation suggestions, and additional proposals. We used descriptive statistics to compare ratings and rankings between the overall panel, service providers and young women, and analysed rationales, feedback, and suggestions with Framework analysis.
Results: Panelists added six proposals in Round 1 and one in Round 2, resulting in a total of 40 improvement proposals. They rated nearly all proposals as very desirable, two thirds as definitely feasible, and nearly all received a top three priority rank from at least one panelist. Frontline service providers stressed foundational skills and a holistic approach while young women preferred specialized training and proposals with more immediate benefits. Overall, panelists perceived positive role models for programme delivery, skills training, and access to land and water as most critical to empower unemployed and out-of-school young women.
Conclusion: Involving young women and frontline service providers in the generation and assessment of proposals to improve socioeconomic empowerment programs in Botswana resulted in a wide range of policy and practice proposals they found acceptable, feasible, and important. High levels of agreement between panelists and strong support for all proposals suggest ample policy space to improve available programs in favor of young women who are most at risk of HIV infection.